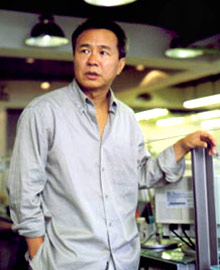C'est une phrase qui vient assez vite à l'esprit lorsqu'on parle de l'oeuvre de ce cinéaste taïwanais, révélé en 1992 par Les Rebelles du Dieu Néon, l'un des meilleurs "premiers films" des années 90, une évocation sans complaisance d'une certaine jeunesse désoeuvrée, sans repères, en proie à la confusion de sentiments brouillés par la jungle des nouvelles technologies, bien impuissantes à permettre leur expression. On y découvrait une mise en scène étonnante de maîtrise, de retenue, de rigueur formelle. Comme chez Bresson ou Antonioni, l'émotion n'est pas suscitée par des effets appuyés, emphatiques ou mélodramatiques, mais au contraire par tout ce qui est suggéré, sous-entendu, à peine montré par une caméra qui sait garder ses distances et faire ressentir ainsi la solitude, l'isolement, la tristesse. Ajoutons à cela, un humour très discret, un peu "noir", un peu décalé et absurde, entre Tati et Buster Keaton (influences revendiquées par Tsai et qui le rapprochent d'un autre cinéaste au style assez similaire le palestinien Elia Souleiman), où les déchirements intimes ont parfois comme témoins des amis, des parents, stupéfaits, interloqués littéralement "sidérés" dans des instantanés "gelés", pour faire un anglicisme, de la vie quotidienne qui se "figent" sous ce regard incompréhensif, impuissant, nous rappellant certaines scènes de Kubrick ou de Lynch (amenant aussi le cinéma de Tsai aux portes du fantastique, comme nous le verrons...)
Tsai va développer ensuite ces motifs thématiques et formels dans ses films suivants: Vive l'amour(1994), La Rivière (1997) (son chef-d'oeuvre et sans doute son film le plus "dur"), The Hole (1998), Et là-bas, quelle heure est-il? (2001) en radicalisant de plus en plus sa démarche artistique (les travellings kubrickiens et les plans-séquences antonioniens qu'on trouve encore dans Vive l'amour ou The Hole se raréfient et disparaissent totalement dans Et là-bas... pour ne laisser la place qu'à des plans-séquences fixes privilégiant le travail sur la profondeur de champ et les perspectives) au risque de laisser les spectateurs à la porte de son univers décidément de moins en moins hospitalier...
Non, on n'y entre pas facilement dans ce cinéma. Et son dernier long-mêtrage en date Goodbye Dragon Inn (2004) pourrait être l'illustration littérale de ce constat ou du moins des interrogations qu'il suscite. Le thème de l'accès à l'image, à la représentation, du point de passage entre le spectateur et l'écran et de ce que l'on y projette est au coeur de ce film.
Que raconte Goodbye Dragon Inn? Une fois de plus, chez Tsai Ming-Liang, des personnages vont se chercher, se croiser, ne pas se trouver du tout, sans pouvoir véritablement communiquer, transmettre leurs sentiments, leurs déchirements intimes... Nous sommes dans une salle de cinéma sans doute à Taïpei, dans laquelle on projette le classique du "wu-xia-pan" (film de "sabre" chinois) Dragon Inn, réalisé par King Hu (1966), devant une audience d'abord importante, puis qui va se réduire petit à petit, jusqu'à ce que la salle soit totalement vide (auto-dérision peut-être, dans cette mise en abyme: Tsai veut-il anticiper l'éventuelle et sans doute -habituelle- réaction du public devant ses propres films, si austères qu'ils auraient aussi tendance à "vider" les salles?) Pendant cette séance, on va suivre deux "intrigues" parallèles: la jeune femme qui travaille au gichet, handicapée (elle a un pied-bot) semble chercher dans tous les recoins du batiment le projectionniste pour qui elle a préparé un gâteau d'anniversaire. On comprendra à la fin du film qu'elle est certainement secrètement amoureuse de lui. Pendant ce temps, un jeune japonais qui est entré en resquillant, va très vite se désinteresser du film pour errer, lui aussi, dans la salle, puis dans les couloirs, les "coulisses", les toilettes du cinéma, en croisant des silhouettes fantomatiques, assez inquiétantes (sont-elles toutes réelles ou seulement des "projections" mentales, issues de l'imaginaire du personnage?). Il y a probablement des fantômes dans ce cinéma, comme au 4eme étage qu'on dit "hanté" de l'immeuble où vit l'un des personnages des Rebelles du Dieu Néon, comme dans l'hôtel Overlook du Shining de Kubrick... Le fantôme étant le symbôle par excellence des souvenirs, de la mémoire, de ce qui "revient" du passé, de l'au-delà. Comme pour nous rappeler, un fois de plus, que ce sont eux, les fantômes, qui peuplent souvent un écran de cinéma.
Il serait tentant de voir dans Goodbye Dragon Inn, un simple hommage style "Dernière Séance" au bon vieux cinéma de Papa, aux petites salles de quartier, aux vieux films de genre etc. Mais il serait tout de même assez tentant aussi de rétorquer immédiatement que question "hommage", Ang Lee avec Tigre et Dragon et Tarantino avec ses Kill Bill sont bien plus explicites. Pourtant, dans une certaine mesure et sans doute pas des moindres, le film de Tsai Ming-Liang l'est. Assurément. D'ailleurs, dans ses interviews, le cinéaste Taïwanais le revendique ouvertement: "Le film de King Hu représente pour moi l'âge d'or du cinéma Taïwanais et la qualité de ces films faits dans les années 60. Voilà pourquoi je montre l'intégralité du générique de ce film au début de mon film. C'est une façon pour moi de rendre hommage aux cinéastes de cette époque et de les présenter au public d'aujourd'hui." déclare-t-il au site web "Reverse Shot"
Mais, en ce qui me concerne, et à la lumière d'autres déclarations dans la même interview, je pense plutôt que la référence au cinéma de genre et la fermeture du cinéma de quartier peuvent aussi évoquer l'image d'un passé condamné à disparaître, écrasé par le rouleau-compresseur du système hollywoodien, de son effrayante machinerie médiatico-publicitaire, devant laquelle les films d'"artisans" comme King-Hu ne peuvent rien faire. La fermeture du cinéma (et Tsai précise bien que même si le panneau indique fermeture "temporaire", il faut y voir un euphémisme typiquement asiatique masquant discrétement le fait que la fermeture est bel et bien définitive) marque la fin d'une époque, d'un point de vue plus général que strictement cinématographique. D'ailleurs, contrairement à Cinema Paradiso, nulle trace ici d'une célébration béate et simplette de la fascination pour le cinéma d'antan. Le cinéma, pas plus que n'importe quel moyen d'expression ne facilite la communication entre les êtres. Les actions des personnages sur l'écran n'ont que très peu d'effet sur les comportements des personnages dans la salle et les couloirs du cinéma. On remarque le contraste saisissant entre les héros bondissant, hommes et femmes d'action typiques des films de la Shaw Brothers, capables de réagir promptement face aux situations problèmatiques ou dangereuses (à coup de sabre, bien souvent!) et le statisme, la glaciation des mouvements qui semble affecter le jeune Japonais et les spectateurs qui croisent son chemin.
L'opposition entre le cinéma de genre et celui que pratique Tsai Ming-Liang apparait tout de même en filigrane, même si Tsai ne revendique aucun rejet de ce type de film, bien au contraire. Mais l'on ne peut que constater la différence flagrante entre une mise en scène vire-voltante, aux mouvements de caméra dynamiques, au découpage souvent "heurté", des intrigues généralement saturées de temps forts, de rebondissements haletants, débouchant, en principe, sur un dénouement sous forme de résolution de crise, propre au divertissement populaire dit "consolatoire" pour reprendre l'expression d'Umberto Eco ET le cinéma en "creux" de Tsai Ming-Liang, où le vide, la vacance, la lacune (marques du cinéma "moderne" selon Deleuze), les temps "morts" et les longs plans-séquences fixes, la rareté des mouvements d'appareil sont les figures dominantes et où, comme c'est encore le cas ici, la fin n'apporte aucun apaisement, aucune résolution mais reste comme dirait également Eco "problèmatique". A l'instar du portrait de James Dean que contemplait le jeune protagoniste des Rebelles du Dieu Néon, la jeune femme handicapée regarde longuement une jeune guerrière sur l'écran se livrer à des combats acrobatiques et à des prouesses physiques à des années-lumière de sa propre démarche claudiquante, lente et douloureuse. Le roman à l'eau de rose posé sur sa table dans le gichet rappelle aussi ce décalage souvent pénible entre le rêve qu'apportent les divertissements populaires et la réalité, bien moins clémente (et c'est ici le mélodrame, autre genre populaire par excellence, qui transparait, comme dans beaucoup de films asiatiques, d'Ozu à Wong Kar-Wai, en passant par Kurosawa, dont les sujets résumés à de simples "pitches" pourraient sembler provenir de vulgaire soap-operas s'ils n'étaient transcendés par une mise en scène et un sens du récit beaucoup plus ambitieux...)
Dans la salle, se trouvent également des personnages, qui semblent bien être les acteurs qui incarnaient les héros du film de King-Hu, en train de se regarder sur l'écran. Là aussi: saisissant contraste entre les corps des jeunes guerriers bondissants qu'ils furent grâce à la magie du cinéma et les silhouettes figées, les visages parcheminés de rides qui apparaissent saisis en gros plan dans la pénombre de la salle, que vient d'ailleurs scruter le jeune Japonais dans une séance de drague gay peu courronée de succès...
Tsai semble très sceptique face à la portée réelle de ce cinéma de l'"oubli". Il ne sera d'aucune aide aux personnages qui regardent le film. Il ne favorise pas plus la communication que les machines, jeux video, téléphones, écrans de surveillance qui parsèment ses autres films...
J'oserais un petit point de vue polémique pour finir sur la question de l'hommage au "genre". J'ai toujours été un peu géné par une vision nostalgique qui opposerait bon vieux cinéma de papa à l'ancienne fait avec amour par des artisans et grosses machines modernes dirigées par des commerçants sans âme... C'est quand même faire semblant d'ignorer que la différence se situe surtout au niveau des moyens financiers, de l'économie de production et que, de manière evidemment moins agressive, les séries B, les film de "genre" "sympa", appartiennent quand même à l'industrie du divertissement de masse et obéissent à une logique de contentement des foules à l'aide de produits bien calibrés pour plaire au plus grand nombre. Mario Bava, Terence Fisher ou King-Hu n'avaient pas quand même pas pour but de vraiment bousculer intellectuellement leurs spectateurs. En cela, ils ne sont pas si radicalement éloignés d'un Hollywood volontiers présenté comme l'antithèse de ces "modestes artisans"...
Ce qui n'empêche pas que ce cinéma-là soit respectable, à condition de ne pas l'idéaliser outre-mesure. Cela me fait penser d'ailleurs à l'admiration que porte Tsai Ming-Liang à Truffaut et à qui il rend hommage dans le très beau Et là-bas, quelle heure est-il?, qui, comme Goodbye Dragon Inn est traversé par une référence à un autre film, ici: Les 400 Coups. Truffaut, comme tous les critiques des Cahiers du Cinéma dans les années 50, devenus ensuite les cinéastes de la "Nouvelle Vague", avaient courageusement réhabilité un certain cinéma jusque là regardé de travers par la critique officielle: westerns, polars, comédie etc... Mais bizarrement, Truffaut n'a jamais signé de vrai "divertissement", il n'a jamais fait "fantomas" ou "Angélique"! Et, Tsai Ming-Liang ne fait pas du Tsui-Hark!
Il semble donc que cette vénération du bon "cinoche" ait quelques limites...
Voilà pour la "polémique" qui selon Truffaut lui-même, d'ailleurs, ne "fait jamais de mal"!
Goodbye Dragon Inn est un film évidemment d'un abord assez difficile, mais la maîtrise formelle de Tsai Ming-Liang et l'atmosphère envoûtante de ce cinéma au bord de l'oubli en font une oeuvre troublante et au fond assez attachante...
(Eh! J'ai réussi à faire tout un article sur Tsai Ming-Liang sans parler du thème de l'élément liquide! Dingue, non?)